Temps de lecture : 7 minutes
Rendre les étudiant·es acteurs de leur initiation à la recherche, croiser les regards disciplinaires, construire un collectif autour des enjeux culturels et politiques : deux ans après le lancement du club ORION « Culture et politique », Stéphane Guy et Nicolas Brucker nous racontent comment cette aventure continue de susciter des vocations et de fédérer une communauté engagée.
Factuel : Pourquoi avoir créé un club ORION ? Pouvez-vous le présenter brièvement ?
Stéphane : L’idée du club s’est fait jour d’une part à partir du constat d’un cloisonnement disciplinaire (entre lettres, langues, sciences humaines et sociales). Mes recherches en civilisation britannique et en études anglophones m’avaient déjà sensibilisé à l’importance du dialogue entre les disciplines à travers l’étude d’une aire culturelle et il me semblait pertinent de développer un club permettant aux étudiants d’appréhender cette dimension interdisciplinaire de la recherche, au-delà des spécialisations et des clivages scientifiques et institutionnels.
L’autre dynamique qui a conduit à proposer le club était plus large : tout en promouvant les spécificités de chaque discipline, le club « Culture et politique » pouvait proposer une véritable réflexion aux étudiants sur les interactions entre leur domaine de compétence et les débats sociétaux, passés ou présents. Les possibilités offertes par le club leur permettraient de comprendre que, tout en s’appuyant sur une démarche scientifique, le chercheur est sans cesse en prise avec le monde et que ses activités sont traversées par les débats, les préoccupations, les valeurs voire les préjugés, de la société dans son ensemble.
Nicolas : J’ajouterai une remarque plus générale. Le club étudiants-chercheurs est un concept familier de nos collègues des sciences expérimentales et formelles. En science humaines, nous en ignorions l’existence jusqu’à récemment. Le grand intérêt d’un club ORION est d’initier à la recherche non de façon théorique, mais de façon pratique, par l’expérience et la participation de chacun dans un cadre collectif.
Dans la maquette de nos masters, figurent des cours de méthodologie, d’initiation à la recherche ou de présentations des thématiques scientifiques de nos laboratoires. Tout cela est statique et maintient l’étudiant dans une certaine passivité. La philosophie d’un club est de rendre l’étudiant acteur de son initiation à la recherche : c’est à lui qui revient l’initiative. Comme Stéphane, j’insisterai sur l’ouverture interdisciplinaire : dans les pays anglophones, les bachelors permettent de se former dans plusieurs disciplines simultanément. La France se distingue par des filières précocement spécialisées. Le parcours ORION permet de compenser ce phénomène.
Factuel : Qu’apporte ce club à votre laboratoire ?
Stéphane : L’un des atouts du club est qu’il traduit de manière concrète les recherches que mènent les membres d’IDEA (Interdisciplinarité dans les Etudes Anglophones) sur les interactions entre l’histoire, la littérature et les arts, la linguistique ou la politique. D’une certaine manière, le club offre aux membres du laboratoire une image de ce qu’est la recherche interdisciplinaire et peut-être même qu’il contribue à renforcer l’identité scientifique de l’unité. L’autre atout du club pour IDEA est qu’il permet aux encadrants et enseignants anglicistes d’approfondir leurs liens avec les chercheurs d’autres unités qui ont aussi encouragé leurs étudiants à rejoindre l’équipe et qui travaillent sur d’autres champs culturels.
Nicolas : Le mot-clé est en effet le décloisonnement. Un laboratoire est d’abord une structure administrative, et force est de constater que les logiques administratives l’emportent souvent sur les dynamiques scientifiques. Un club ORION limite ce risque : il permet à des chercheurs de différents laboratoires de se rencontrer, se découvrir et envisager ensemble des collaborations scientifiques. Entre Ecritures, auquel j’appartiens, et IDEA, auquel appartient Stéphane, des sujets communs émergent qui pourront à terme être l’embryon de futurs projets scientifiques.
Factuel : Quels projets ou activités avez-vous développés ?
Stéphane : Les doctorants-managers ont montré un dynamisme et une créativité exceptionnels : grâce à eux, les membres du club ont pu développer des projets originaux. Outre les rencontres mensuelles qui font souvent intervenir des chercheurs sur les enjeux politiques et culturels de leur recherche (avec des cas pratiques et des illustrations concrètes), les membres ont pu organiser des cafés littéraires et des ateliers d’écriture, donner des conférences, créer des podcasts et monter intégralement deux journées d’études où ils présentent les recherches menées pendant l’année écoulée.
Nicolas : Le club a également financé partiellement des missions de recherche menées en archive par les masterants. La création, en 2024-2025, de mini-équipes au sein du club qui valorisaient et travaillaient sur une thématique abordée par les étudiants de Master dans leur mémoire a aussi donné lieu à une belle synergie entre les membres.
Factuel : Comment le club ORION a-t-il transformé la manière dont votre laboratoire interagit avec la communauté étudiante ?
Nicolas : Le club ORION invite chacun, étudiant ou enseignant, à être vraiment ce qu’il doit être : l’étudiant tendant vers l’autonomie et l’initiative, l’enseignant donnant l’orientation générale de façon souple et non contraignante. Entre les deux, le manager assure l’animation. Le partage des rôles est clairement posé. Ce qui compte, c’est au fond la dynamique scientifique qui se noue au gré des échanges et des actions. Etudiants et enseignants sont entraînés dans un même élan, une même passion partagée : celle de la recherche académique.
Stéphane : Le club a beaucoup participé à rendre le laboratoire IDEA visible parmi les étudiants. En sciences humaines et sociales, le principe du « laboratoire » reste souvent peu compréhensible, par contraste avec les sciences dites dures, pour le grand public et plus précisément pour les étudiants de licence et de master. Le club a permis d’associer les travaux des étudiants à ceux des collègues, remplissant ainsi sa vocation fondamentale d’instiller le goût de la recherche dès la L2.
Nicolas : Sur ce point de la visibilité, j’ajouterai que, grâce au club, nos laboratoires ont renforcé leur position d’acteur de la formation. Cela peut d’ailleurs conduire à repenser le dialogue entre composantes de formation et composantes de recherche. En définitive, le laboratoire est mieux identifié par les étudiants, qui très tôt peuvent l’intégrer à leur projet.
Factuel : Quels conseils donneriez-vous aux scientifiques souhaitant créer un club ORION ?
Nicolas : On pourrait penser que le succès d’un club tient avant tout à la thématique scientifique. Ce n’est pas faux. Mais ce qui compte encore plus c’est l’engagement des doctorants-managers, leur aptitude à coordonner, organiser, administrer. La sélection des doctorants me paraît donc l’étape essentielle qui garantira la réussite du club. Mais les doctorants finissent un jour par soutenir leur thèse. C’est tout le mal qu’on leur souhaite ! Il faut donc anticiper et songer à la suite si l’on vaut maintenir le club.
Stéphane : Dans la mesure du possible, il faut veiller à ce que l’objet de recherche du club soit véritablement interdisciplinaire et suffisamment ample, pour que les étudiants se confrontent à des perspectives tout autres que celles qu’ils suivent habituellement dans leur cursus. Plutôt qu’un approfondissement de la formation dispensée en licence ou en master, le club pourra porter des fruits s’il est véritablement ouvert à des champs variés et s’il peut accueillir différents profils d’étudiants issus de plusieurs départements.






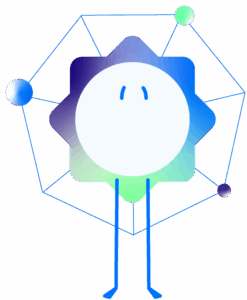


![Vers l'article [Retour sur] La Fête de la Science 2025 au LEM3](https://factuel.univ-lorraine.fr/wp-content/uploads/2025/10/251014_lem3-photo-fds25-vendredi-19-300x225.jpg)




