Temps de lecture : 7 minutes
2025 marque la cinquième édition du prix littéraire « Frontières ». Cette semaine, faisons connaissance avec Philippe Cossalter qui vient d’intégrer le jury. Philippe Cossalter est professeur agrégé de droit public, titulaire de la Chaire de droit public français et Directeur du Centre juridique franco-allemand de l’Université de la Sarre. Il est également administrateur de la Chapelle Sainte-Blandine (Metz).
Qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre le jury du prix littéraire « Frontières » de l’Université de Lorraine ?
J’ai volontiers accepté l’invitation de Carole Bisenius-Penin, car j’ai la culture qui se fait. À vrai dire, j’ai pour habitude de ne lire que des auteurs morts. Je pense que le temps exerce un incroyable filtre et qu’une vie, aussi longue soit elle, permet à peine de lire les chefs d’œuvre du passé. Les exceptions ont été rares jusqu’ici : Paul Auster, TC Boyle ou Jean Rouaud par exemple, toujours un peu par hasard.
Mais les hasards de la vie m’ont poussé vers la culture vivante. D’abord à travers l’association Sybaris. Ensuite à travers la Chapelle Sainte-Blandine. Elles ont été les vecteurs de ma passion pour la musique et les arts visuels. Elles ont été probablement l’une des raisons de l’invitation à participer au jury du prix littéraire « Frontières ». La culture est un tout ; et elle est une passion vivante. Pour la première fois j’ai été invité à m’essayer à lire des productions récentes. Et pour la première fois je suis appelé à donner mon avis, tandis que j’ai pour habitude de suivre ou de délaisser un livre, de l’adorer ou de l’abandonner. Pour le prix littéraire « Frontières », je dois tout lire, que j’aime ou non ce que je lis, et surtout sans le biais de confirmation d’une renommée établie. Cela nécessite une véritable discipline. C’est stimulant.
La thématique de la frontière a-t-elle une signification particulière dans votre vie quotidienne et quel intérêt de participer à un jury transfrontalier ?
Je suis un frontalier. Je vis à Metz, mais je suis depuis 15 ans professeur de droit public à l’Université de la Sarre où je dirige le Centre juridique franco-allemand. Je passe donc la frontière franco-allemande plusieurs fois par semaine.
Dans mon activité scientifique et pédagogique je suis amené à m’intéresser non seulement au transfrontalier (Grenzüberschreitend) qui est une notion parfois un peu vague, mais plus précisément encore au frontalier (Grenznachbar). Le droit frontalier, sous le titre allemand de Grenznachbarliches Recht est l’un de mes sujets d’étude. Comme en linguistique, la frontière est bordée d’une zone où se rencontrent et se mêlent plusieurs influences. C’est très net en matière de droit du travail, de droit fiscal, de droit social : tous les frontaliers l’expérimentent quotidiennement, mais aussi en matière de police, de justice, de services publics notamment. Il existe à la frontière des travailleurs frontaliers avec un statut fiscal particulier ; le droit des marchés publics connait des perturbations. C’est d’une véritable branche d’étude qu’il s’agit. La thématique de la frontière fait donc partie de mon quotidien, à titre aussi bien personnel que professionnel.
Par ailleurs, pensez-vous que cette expérience en tant que membre du jury pourrait influencer votre relation avec la littérature ou la lecture ?
Comme je l’ai dit, j’ai une pratique de la lecture très orientée et parfois un peu docte. Et je me méfie généralement des nouvelles productions, exception faite de la poésie. Je ne lis que rarement les derniers prix littéraires, je ne suis que peu l’actualité. Mais à vingt ans j’étais beaucoup plus proche de la littérature qui se fait. L’Opération « 2000 jeunes pour l’an 2000 », dont quelques nostalgiques de ma génération se souviendront, m’avait permis de me plonger dans la frénésie de la poésie, de la littérature, du théâtre. C’était alors l’occasion de voir les choses se faire et de rencontrer les artistes. Cela clôturait une période de dix ans pendant laquelle je lisais de manière frénétique. À partir de la fin des années 90, Internet est arrivé. J’y ai plongé corps et biens. J’ai même payé une partie de mes étude doctorales en étant webmestre. C’est, je pense, ce moment-là, et l’arrivée de l’âge adulte et de ses contraintes, qui m’a éloigné de la littérature.
Le prix littéraire « Frontières » peut être un moyen de revenir à une approche plus aventureuse de la littérature, en cherchant des perles dans des œuvres récentes, plutôt qu’en visitant les vestiges des panthéon littéraires.
Quel livre a marqué votre vie ?
Sexus d’Henry Miller. C’était un beau livre orange de chez Christian Bourgois. Il était épais et placé sur une étagère suspicieusement haute dans la bibliothèque familiale. Je n’ai jamais vraiment lu étant enfant ; je n’ai eu aucune appétence pour la bibliothèque verte. Mais à douze ans j’ai entamé mon éducation littéraire avec une œuvre magistrale. Non pas la bibliothèque rose mais La Crucifixion en rose. À vrai dire, et malgré le titre provocateur, ce n’est pas une œuvre pornographique du tout. C’est une histoire littéraire et une plongée dans un monde qui me faisait rêver : le New York des années 1920. Ce livre et ceux qui le suivent, Plexus et Nexus, sont aussi une manière, autobiographique, d’inviter le lecteur dans un voyage littéraire. À travers Miller, j’ai ensuite découvert Knut Hamsun, Lawrence Durrell ou Anaïs Nin (autrement plus sulfureuse que Miller, d’ailleurs).
Je serais ingrat si je ne disais pas que ma psyché littéraire a été construite par un couple : son deuxième membre était Vladimir Nabokov que j’ai découvert à 14 ans. C’est une toute autre délectation littéraire, étrangement plus physique. On pourrait penser que Miller est physique et Nabokov intellectuel. Mais pour moi, c’est l’inverse. Miller est un intellectuel dans tous les actes de sa vie, même les plus ordinaires ou sordides. Nabokov, lui dans un langage plus maîtrisé, s’adresse aux sensations ; c’est une forme de rêve éveillé, un Proust qui aurait voyagé. Feu pâle ou La Vénitienne par exemple invoquent la sensation de chaleur au milieu de la neige. La Vénitienne, à côté de Sexus, est donc mon deuxième livre fétiche et, au sein de ce recueil de nouvelles, Un coup d’aile tient une place à part, l’histoire d’un ange dans une station de ski. C’est une pure émotion, une image intense. On en revient, peut-être, aux arts graphiques.
Rendez-vous le samedi 5 avril 2025 à l’hôtel de ville de Metz pour la remise du prix au lauréat ou à la lauréate !



![Vers l'article [Retour sur] La remise du Prix littéraire Frontières 2025 à Elitza Gueorguieva](https://factuel.univ-lorraine.fr/wp-content/uploads/2025/04/prix_litteraire_-_factuel_carre-300x300.png)
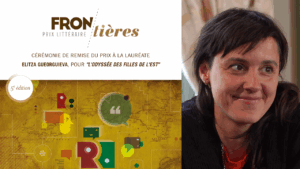
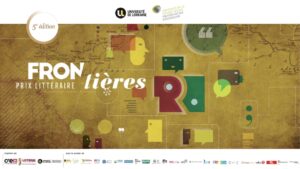
![Vers l'article [Prix littéraire Frontières] Venez participer à la remise de prix de la 5e édition !](https://factuel.univ-lorraine.fr/wp-content/uploads/2025/04/visuel_1080_1080_px_2025-300x300.jpg)








