Temps de lecture : 4 minutes
Informations pratiques
Pour la semaine de la recherche, l’Institut Élie Cartan de Lorraine propose aux étudiants et étudiantes de découvrir les métiers et activités des chercheurs scientifiques en mathématiques à travers des exposés, la visite de la bibliothèque et des échanges avec les doctorants.
Programme
Lundi 22 septembre de 13h à 14h : à destination des L2/L3/DU Maths
Visite de la bibliothèque de l’IECL – 2ème étage
Inscription obligatoire par mail avant le 18 septembre à Thomas Stoll
(S’il y a plus de 15 inscriptions, un deuxième créneau sera proposé mardi 23 septembre de 13h à 14h)
Mercredi 24 septembre de 16h15 à 18h30 : à destination des M1 Maths
Salle de conférences de l’IECL – 2ème étage
16h15 à 17h30 : Exposé de Coralie Fritsch : Introduction aux activités du chercheur et exemples de projets en mathématiques appliqués à la biologie
Résumé : Le but de cette séance est tout d’abord de présenter les métiers et activités des chercheurs scientifiques. Je présenterai ensuite mon parcours et quelques uns de mes projets de recherche en probabilités et statistiques appliquées à biologie et la médecine. Il n’y aura aucune technique mathématique dans cet exposé qui a pour but de présenter un exemple de profil de recherche.
17h30-18h30 : Échanges avec les doctorant.e.s de l’IECL
18h30 : Discussions informelles autour d’un pot
Jeudi 25 septembre de 14h à 15h30 : à destination des L2/L3/DU Maths
Bâtiment Henri Poincaré – 1er cycle – Amphi 11
Exposé de Rémi Peyre : QCM bayésiens : Les probabilités au service de la méta-connaissance
Résumé : En tant qu’étudiants, voilà déjà une quinzaine d’années que vos enseignants testent régulièrement vos connaissances. Le principe de base est toujours plus ou moins le même : on vous pose une série de questions ; vous proposez vos réponses ; et plus votre nombre de réponses correctes est grand, plus on considère que votre maitrise du sujet est élevée ! Cette méthode d’évaluation, si naturelle soit-elle, présente néanmoins un point aveugle : elle ne permet pas de prendre en compte la méta-connaissance des étudiants interrogés… Qu’entends-je par là ? Imaginez deux météorologues chargées de dire si, le lendemain, il pleuvra ou pas (voir le diagramme et la légende ci-joints). Chaque jour, Madame A propose une prédiction « ordinaire », qui s’avère correcte trois fois sur quatre ; tandis que Madame B, un jour sur deux, propose une prédiction « certifiée » (qui s’avère alors toujours correcte), et un jour sur deux, se contente d’une prédiction « aléatoire » (qui ne fait pas mieux que le hasard). Dans une telle situation, les annonces de Mme A et de Mme B recevraient la même note pour une évaluation “classique” ; néanmoins, le fait que Mme B sache distinguer ses prédictions certifiées de ses prédictions aléatoires rend ses annonces plus utiles ! On parle de méta-connaissance pour se référer au fait que Mme B, dans ses prédictions, sait à quel point elle sait. Or, la méta-connaissance est une capacité essentielle dans l’application des connaissances acquises au cours de notre instruction académique, et même dans la vie citoyenne en général… Dès lors, se pose une question naturelle : comment évaluer les connaissances d’une façon qui incite à faire preuve aussi d’une bonne méta-connaissance ? Il se trouve qu’il existe un outil élégant et astucieux permettant de relever ce défi : les QCM bayésiens ! Ce sera le thème de ma présentation. Qu’est-ce qu’un QCM bayésien ? Que vient faire ici l’adjectif « bayésien », relatif à la formule de Bayes en théorie de probabilités ? Quel rapport entre tout cela et la recherche ? Pour le savoir, rendez-vous le 25 septembre…!
Voir diagramme
Nous serons heureux de vous accueillir et de répondre à toutes vos questions.









![Vers l'article [Semaine de la Recherche] Escape Game : osez visiter le LCOMS !](https://factuel.univ-lorraine.fr/wp-content/uploads/2025/09/imageescapegamelcoms-300x285.jpg)



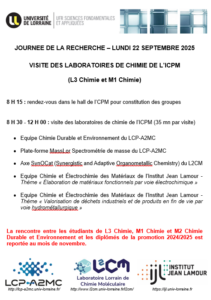
![Vers l'article [Sexpop #1] Apéro scientifique : repenser les normes dans la série Arcane](https://factuel.univ-lorraine.fr/wp-content/uploads/2025/09/Affiche-apero-Arcane-212x300.jpg)
