Temps de lecture : 6 minutes
Depuis 2021, des spécialistes en IA, en traitement automatique des langues (TAL) et en sciences humaines et sociales analysent 35 ans de délibérations du Conseil constitutionnel dans le cadre du projet ANR Isovote*. Une exploration interdisciplinaire de la mécanique de ce pilier de la démocratie française, que nous relatent deux professeurs de l’Université de Lorraine, Samuel Ferey, coordinateur du projet et économiste au sein de BETA (UMR 7522, Université de Lorraine, Université de Strasbourg, CNRS, INRAE), et Maxime Amblard, enseignant-chercheur en informatique au LORIA (CNRS, Université de Lorraine) et au Centre Inria de l’Université de Lorraine.
Factuel : Comment est née l’idée du projet Isovote ?
Samuel Ferey : En premier lieu, c’est l’existence d’un matériau rare qui l’a motivé. En vertu d’une loi de 2008 sur la diffusion des délibérations du Conseil constitutionnel, il nous était possible d’exploiter l’intégralité des procès-verbaux établis entre 1959 et 1995. Ensuite, nous avons misé sur la puissance des outils de TAL (Traitement automatique des langues) combinés à l’IA. Tout était réuni pour effectuer un travail inédit et de grande qualité scientifique.
Maxime Amblard : Jusque-là, faute de disposer de tels moyens, les chercheurs et chercheuses qui s’intéressaient au Conseil constitutionnel n’étudiaient que quelques délibérations à la fois. Innovation majeure, nous avons proposé de mener des analyses exhaustives et largement automatisées, de dégager des tendances sur plusieurs années ou décennies. Cette approche a attiré vers nous des collègues d’horizons variés : informatique bien sûr, mais aussi économie, droit public, histoire, sciences politiques et philosophie politique. Cette interdisciplinarité nous permet de mieux comprendre comment le Conseil constitutionnel a accompagné les transformations de l’État en France depuis les débuts de la Ve République, en croisant les éclairages.
Factuel : Concrètement, comment le travail au sein de votre équipe s’est-il organisé ?
S. Ferrey : Nous disposions au départ de plus de 300 procès-verbaux au format PDF. L’enjeu était de les convertir en un corpus qui puisse être interrogé pour les besoins de toutes les disciplines impliquées. Nous avons donc réfléchi ensemble, spécialistes de l’informatique et spécialistes des sciences humaines et sociales, à ses caractéristiques : que comptions-nous explorer exactement ? Quelle proportion d’erreurs pouvions-nous tolérer dans le texte final ? Comment structurer le contenu des PV pour différencier les formules de politesse, la lecture de rapports préliminaires, les dialogues entre conseillers, les votes proprement dits, etc. ?
M. Amblard : Il existait dès 2021 des logiciels puissants pour convertir du PDF en texte, mais leur taux d’erreur restait trop élevé pour produire un corpus exploitable. Passer de 10% à 0,5% d’erreurs nous a pris du temps, d’autant que le travail de structuration était important. Nous l’avons fait en associant des outils de TAL, des outils d’IA qui en étaient directement issus, et des corrections manuelles pour certaines tâches : par exemple, réattribuer certains fragments de dialogues au bon conseiller ou à la bonne conseillère, ce qui peut changer du tout au tout le sens d’un débat.
Factuel : Qu’apporte la mise à disposition de ce corpus normalisé et structuré ?
M. Amblard : C’est le résultat fondateur, le socle qui va permettre à nos collègues de mener leurs travaux dans leurs disciplines respectives. Dans mon registre, celui du TAL, il est rare d’aboutir à un corpus aussi technique – le droit est omniprésent – constitué en outre de dialogues, donc d’interactions non formatées, de didascalies, etc. J’ai dû recourir à des méthodes spécifiques pour en arriver là. Quant à l’IA, elle a permis d’automatiser beaucoup de tâches et sert désormais à interroger ce corpus, par exemple pour quantifier la fréquence de mots ou d’arguments, analyser des similitudes ou détecter des évolutions à long terme.
Factuel : Pour l’heure, des recherches ont-elles déjà été menées grâce à ce corpus ?
S. Ferrey : Les membres de l’équipe ont d’abord évalué si le vote des conseillères et conseillers était influencé par la couleur politique de celle ou celui qui les avait nommés. Ils ont conclu que ce n’était pas le cas : les processus de délibération du Conseil constitutionnel limitent d’eux-mêmes les possibilités de vote partisan. Cette publication est en cours chez Springer. Parallèlement, nous avons publié des analyses plus complexes sur les paradoxes de vote, afin notamment de voir si le vote au Conseil constitutionnel était sensible au paradoxe doctrinal. Enfin, nos outils et notre corpus commencent à être utilisés par d’autres chercheurs et chercheuses. Je pense par exemple à l’ouvrage de Dominique Rémy-Granger, Les Mots de Robert Badinter, qui va paraître en 2025.
M. Amblard : Outre ces premiers résultats, nous avons de nombreux articles en cours afin de mieux saisir le processus de délibération. Et notamment, comment s’élaborent, étape par étape, les décisions du Conseil constitutionnel ? Quels types d’arguments juridiques sont employés ? Quels conseillers prennent le plus la parole ? Forment-ils des coalitions ? Quelle est l’influence du principe constitutionnel d’égalité entre les citoyens dans l’élaboration des décisions ? Enfin, d’autres équipes de chercheurs et chercheuses pourront utiliser le corpus quand celui-ci sera mis à disposition.
Factuel : D’ores et déjà, quels sont à vos yeux les impacts d’Isovote ?
S. Ferrey : Le projet suscite un vif intérêt auprès du Conseil constitutionnel, très engagé depuis la présidence de Robert Badinter (de 1986 à 1995) dans la diffusion de ses documents internes vers le public. Le Conseil est particulièrement intéressé par le rôle de l’IA en droit constitutionnel, afin d’en saisir les opportunités et les limites ; nous devons échanger sur ce sujet avec ses services à l’automne.
M. Amblard : Isovote a amené des chercheurs et chercheuses de disciplines très différentes à travailler ensemble et à apprendre ce que chacun pouvait tirer des recherches des autres. Parallèlement, le projet a permis d’améliorer Tacteo, notre plate-forme collaborative de transcription et d’annotation de corpus à partir de sources numérisées. C’est une avancée pour les chercheurs en sciences humaines et sociales qui disposent de documents de centaines de milliers de mots, voire plus, mais ne sont pas toujours outillés pour les exploiter en l’état. D’autant que Tacteo garantit le respect strict de la réglementation sur les données de la recherche, ce qui n’est pas forcément le cas des logiciels propriétaires.
* ANR-21-CE41-0008, Isovote 2021-2025.
Plus d’infos sur le laboratoire LORIA sur ce lien
Source : inria.fr
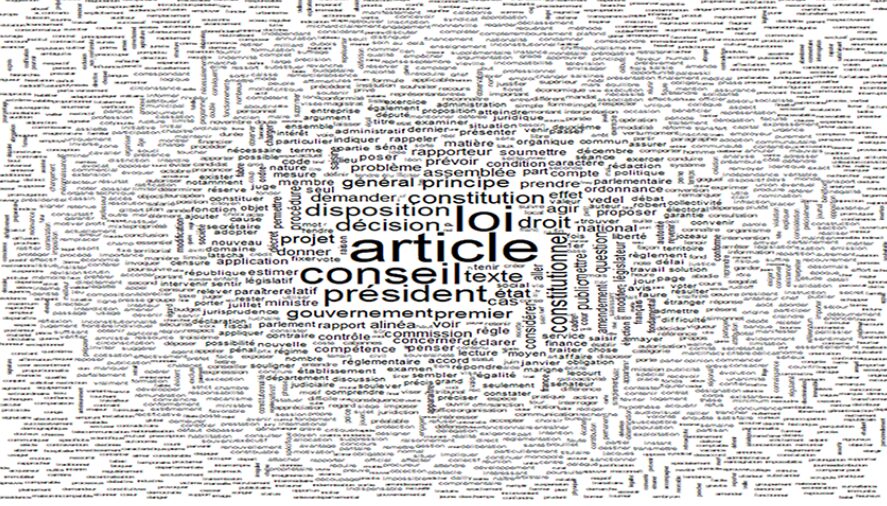







![Vers l'article [Deep Change Lab] 20 nouveaux ambassadeur·drice·s de l’innovation](https://factuel.univ-lorraine.fr/wp-content/uploads/2026/01/Deep-Change-Lab-300x300.jpg)




![Vers l'article [UNYS] Interview de LAETITIA MINARY](https://factuel.univ-lorraine.fr/wp-content/uploads/2026/01/bc93271f95567aeb11c13ce8de75fc96-300x169.png)

