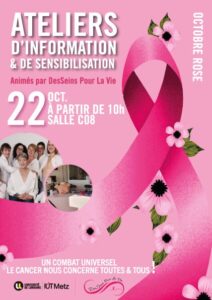Temps de lecture : 7 minutes
L’Université de Lorraine se mobilise pour Octobre Rose, le mois de la prévention du cancer du sein. Durant le mois d’octobre, nous allons à la rencontre de nos laboratoires pour mettre en lumière leurs expertises et leurs travaux de recherche sur cette thématique cruciale.
C’est également l’opportunité de rappeler que la recherche se mobilise toute l’année sur ce sujet. Nous avons échangé avec Céline Frochot, chercheuse CNRS en thérapie photodynamique anticancéreuse au sein du Laboratoire Réactions et Génie des Procédés – LRGP (CNRS – Université de Lorraine). Nous avons notamment abordé la thérapie photodynamique mais également le projet de thèse portant sur le cancer du sein qu’elle dirigera à partir de novembre 2025, en co-direction avec Samir Acherar, enseignant-chercheur au Laboratoire de Chimie-Physique Macromoléculaire – LCPM (CNRS – Université de Lorraine), en coopération avec Miffy Hok Yan Cheng de University of British-Columbia, UBC à Vancouver (Plus d’informations). La thèse financée par le CNRS via le programme « Call for Proposals 2025 – UBC-CNRS PhD Joint Program » a été attribuée à Héloïse Vincent.
Pouvez-vous nous présenter brièvement le LRGP ainsi que votre parcours de chercheuse dans le domaine de la thérapie photodynamique anticancéreuse ?
Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédes est une Unité Mixte de Recherche commune au CNRS et à l’Université de Lorraine. Son objectif scientifique général porte sur l’étude des procédés envisagés dans leur globalité et leur complexité. Il développe les connaissances scientifiques et technologiques nécessaires à la conception, à l’étude, à la conduite et à l’optimisation des procédés complexes de transformation physico-chimiques et biologiques de la matière et de l’énergie.
J’ai intégré le CNRS en 2000, au Département de Chimie-Physique des Réactions, qui a fusionné en 2010 avec plusieurs laboratoires de l’ENSIC pour former le LRGP. Le thème de recherche que j’ai proposé lors de ma prise de fonctions de chargée de recherche portait sur le développement de molécules photo-activables vectorisées pour une thérapie photodynamique ciblée. Je développe cette activité interdisciplinaire depuis 25 ans, en coopération notamment avec des chimistes du LCPM (CNRS-UL), des biologistes du CRAN (CNRS-UL) et de ONCOTHAI (INSERM Lille).
Qu’est-ce que la thérapie photodynamique anticancéreuse (PDT) ? Quel est son principe de fonctionnement et son application dans le traitement de certaines formes de cancer ?
La thérapie photodynamique (PDT) fait partie de l’arsenal thérapeutique utilisé pour traiter certains types de cancers ainsi que d’autres pathologies (dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), infections, etc.). Son action repose sur l’utilisation conjointe d’une molécule photo-activable, appelée photosensibilisateur, de la lumière et de l’oxygène. Après excitation lumineuse, le photosensibilisateur transfère soit des électrons aux biomolécules environnantes, soit de l’énergie à l’oxygène, ce qui induit la formation d’espèces réactives de l’oxygène, capables de détruire les cellules cancéreuses. La thérapie photodynamique est utilisée quotidiennement en dermatologie, notamment pour le traitement des kératoses actiniques (lésions pré-cancéreuses) qui touchent environ 3,5 millions de personnes en France chaque année, ainsi que des carcinomes basocellulaires superficiels et la maladie de Bowen (cancer intra-épidermique in situ). De nombreux essais cliniques sont actuellement en cours pour le traitement des cancers de la prostate, du poumon et de l’ovaire. Par ailleurs, un essai clinique de phase II est conduit avec l’entreprise française Hemerion, portant sur le traitement de tumeurs cérébrales inopérables, en première ligne ou en cas de récidive.
Un nouveau projet de thèse démarrera en novembre, pourriez-vous nous en dire plus sur les objectifs principaux ?
Le cancer du sein triple négatif (TNBC) est une forme particulièrement agressive, au pronostic sombre, qui touche principalement les femmes jeunes. La thérapie photodynamique (PDT) pourrait ici représenter une option thérapeutique. Partant du constat que l’hypoxie (manque d’oxygène) constitue une caractéristique bien connue de nombreux cancers agressifs, il faut trouver une solution pour empêcher ce phénomène qui compromet l’efficacité de la thérapie photodynamique. L’objectif principal de la thèse qui débutera en novembre est d’améliorer l’efficacité thérapeutique de la théarapie photodynamique dans les tumeurs en manque d’oxygène grâce à l’administration d’un photosensibilisateur et d’une molécule encapsulée dans des nanoparticules. Concernant les recherches menées au laboratoire, il s’agira d’une part, de synthétiser de nouveaux photosensibilisateurs et, d’autre part, de concevoir des peptides ciblant des récepteurs surexprimés à la surface des cellules cancéreuses, qui seront alors greffés aux nanoparticules. Les propriétés photophysiques des nanoparticules seront ensuite étudiées, en particulier leur capacité à absorber la lumière et à émettre de la lumière (fluorescence) ainsi que leur aptitude à générer des espèces réactives de l’oxygène capables de détruire les cellules cancéreuses.
Comment ces travaux pourraient-ils améliorer la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein à l’avenir ?
Le cancer du sein triple négatif (TNBC)représente environ 15 % des cas de cancers du sein et touche plus particulièrement les femmes jeunes de moins de 40 ans. L’arsenal thérapeutique actuellement disponible est plus limité que pour les autres sous-types de cancers du sein, ce qui rend urgent le développement de nouvelles approches thérapeutiques. La thérapie photodynamique présente un intérêt majeur, car elle peut être associée à d’autres modalités de traitement telles que la chimiothérapie, la radiothérapie ou encore l’immunothérapie. De plus, elle présente l’avantage de ne pas induire de résistance, contrairement à certains traitements.
Cette thèse est réalisée en coopération avec l’Université de la Colombie-Britannique (University of British Columbia, UBC) à Vancouver. Pouvez-vous nous expliquer comment va se passer cette coopération et quels sont les bénéfices pour ce projet ?
Le CNRS et l’Université de Colombie-Britannique (UBC) voient émerger de plus en plus d’opportunités de partenariat pour mener des recherches de pointe à l’échelle mondiale. Ils ont lancé leur premier appel à propositions conjoint, visant à approfondir et à développer leur collaboration dans des domaines d’importance stratégique mutuelle. Dans ce cadre, le CNRS finance une thèse, qui sera conduite par Héloïse Vincent, ainsi qu’un financement destiné à effectuer un séjour annuel au Canada. De son côté, l’UBC finance également un doctorat ainsi que des missions de recherche. Les expertises des laboratoires sont hautement complémentaires. En effet, la synthèse des nouveaux photosensibilisateurs, des peptides et des nanoparticules sera réalisée au LRGP et au LCPM (Céline Frochot et Samir Acherar). Les propriétés photophysiques seront étudiées au LRGP. La partie biologique (expérimentations in vitro) sera conduite à l’UCB (Miffy Hok Yan Cheng). Des modèles de cellules cancéreuses du sein en 3 dimensions (appelés sphéroïdes) seront utilisés. L’expression des récepteurs sera validée. L’intervalle d’exposition à la lumière, les doses de nanoparticules et les doses de lumière détermineront les paramètres thérapeutiques. Afin d’évaluer la réponse antitumorale, des mesures de la viabilité cellulaire seront effectuées pour déterminer l’efficacité du traitement PDT. Ce travail interdisciplinaire ne peut se faire qu’en étroite collaboration entre des laboratoires d’expertises reconnues et complémentaires.
Céline Frochot, directrice de recherche CNRS au LRGP (CNRS-UL)
Samir Acherar, Maîtresse de conférences UL au LCPM, (CNRS-UL)
Héloïse Vincent, future doctorante au LRGP et LCPM, deux UMR (CNRS-UL)





![Vers l'article [INTERVIEW] avec Marine Amouroux, récipiendaire de la médaille de Cristal CNRS](https://factuel.univ-lorraine.fr/wp-content/uploads/2025/10/Marine_ID_Cristal_interieurFactuel-ul.jpg)