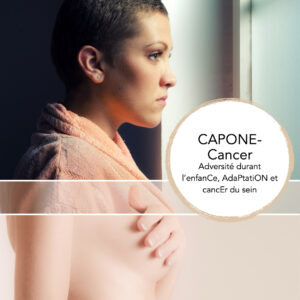Temps de lecture : 8 minutes
Si la lutte contre le cancer se concentre souvent sur les avancées médicales, il est crucial de se pencher sur les facteurs psychologiques pouvant jouer un rôle dans la survenue du cancer du sein et l’efficacité de sa prise en charge (de l’annonce à la rémission). C’est donc l’histoire de vie des patientes en rémission d’un cancer du sein qui est au cœur de l’étude CAPONE-Cancer.
Rencontre avec l’un des porteurs* du projet, le Professeur Cyril TARQUINIO, Directeur-adjoint UMR 1319 INSPIIRE – Université de Lorraine, Inserm et Directeur du Centre Pierre Janet, pour découvrir les enjeux et les perspectives du projet CAPONE-Cancer.
L’Université de Lorraine se mobilise pour Octobre Rose dans le cadre de Bien-être & Co, matérialisation de notre démarche pour la qualité de vie au travail « Réinventons notre rapport au travail ».
Pouvez-vous nous présenter le Centre Pierre Janet et son engagement en faveur de la santé mentale en général ?
Fondé au sein de l’Université de Lorraine par le Pr Cyril Tarquinio en 2015, le Centre Pierre Janet est la première structure universitaire pluridisciplinaire et intégrative dédiée aux évolutions et à l’innovation en santé mentale.
Nous concilions ainsi consultation clinique, recherche et formation professionnelle continue.
En ce qui concerne la Recherche, le Centre Pierre Janet pilote actuellement une dizaine de projets de recherche innovants articulés autour de 3 axes principaux : la prise en charge et l’évaluation, avec un accent particulier sur la santé mentale et les psychothérapies, l’apport des nouvelles technologies de l’E-santé pour transformer les pratiques de soins et la mesure et l’analyse des comportements de santé (le projet CAPONE-Cancer se situe dans cette catégorie).
Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet CAPONE-Cancer ? Quel est l’objectif principal de cette étude ?
L’étude CAPONE-Cancer part d’une interrogation simple : les ACEs (Adverse Childhood Experiences – Expériences Adverses durant l’Enfance), telles que la maltraitance, la négligence ou les violences familiales, peuvent-elles avoir des répercussions sur la santé physique et mentale de l’adulte ? Nous avons donc choisi de nous concentrer sur les femmes en rémission d’un cancer du sein, avec comme hypothèse que celles ayant vécu des ACEs pourraient avoir plus de difficultés à retrouver une bonne qualité de vie après la maladie. Nous nous sommes particulièrement intéressés à l’anxiété, la dépression, la fatigue chronique et la peur que le cancer revienne.
Pour cette étude (désormais close), les participantes volontaires remplissaient tout d’abord une série de questionnaires en ligne (étude quantitative) afin de recueillir des données sociodémographiques, des données médicales, des données sur l’adversité vécue pendant leurs enfance et adolescence et des questionnaires spécifiques afin de mesurer leur qualité de vie, leur niveau de stress ou leur capacité à rebondir face aux difficultés. Une vingtaine d’entretiens (étude qualitative), effectués avec un échantillon de participantes volontaires, ont apporté de précieuses données complémentaires afin de mieux saisir les liens faits par les participantes de l’étude entre leur histoire de vie (en termes d’adversité durant l’enfance) et l’épreuve de la maladie.
Enfin, l’étude comportait des analyses biologiques comme la mesure du cortisol salivaire (un marqueur de stress chronique) ou l’analyse du matériel génétique afin de caractériser leur rôle dans la relation entre adversité et vécu de la rémission.
Quel point est particulièrement innovant dans cette étude ?
Contrairement aux approches traditionnelles qui considèrent le cancer comme un événement isolé, CAPONE-Cancer part du principe que la maladie s’inscrit dans une trajectoire de vie unique, marquée par des expériences passées. Cette innovation s’appuie sur les découvertes en psychotraumatologie et épigénétique, qui tendent à démontrer que les ACEs ne sont pas de simples souvenirs mais des empreintes durables qui modulent notre réactivité biologique et psychologique. Ces traumatismes laissent des traces multidimensionnelles : modifications neurologiques, altérations des systèmes de stress et changements épigénétiques.
La période de rémission, traditionnellement perçue comme un retour à la normalité, est redéfinie comme un moment particulièrement vulnérable où l’histoire traumatique peut resurgir. Par exemple, la qualité de la récupération et la perception de sécurité corporelle peuvent s’en trouver affectées.
Quels sont les potentiels bénéfices de cette recherche pour les patients atteints de cancer ?
À terme, cela permet d’envisager des interventions thérapeutiques personnalisées et préventives, identifiant précocement les patientes à risque pour une prise en charge anticipatoire plutôt que réactive. D’autant que les psychothérapies peuvent aujourd’hui contribuer à modifier significativement les processus pathologiques. En travaillant sur l’histoire de vie des patients, nous pouvons raisonnablement espérer modifier les « cicatrices épigénétiques » laissées par les traumatismes précoces, transformant la vulnérabilité en résilience.
Vulnérabilité et résilience : deux faces adaptatives
La vulnérabilité n’est pas une faiblesse mais une sensibilité accrue au stress résultant d’expériences précoces. Les femmes traumatisées développent souvent une hyperactivation du système nerveux, une production chronique de cortisol et une inflammation persistante, créant un terrain de fragilité lors d’épreuves comme le cancer.
À l’inverse, la résilience représente la capacité à transformer l’adversité en force. Ce processus dynamique implique la capacité à donner du sens aux épreuves, mobiliser des ressources et maintenir l’espoir. Elle se développe à travers des relations sécurisantes et des apprentissages adaptatifs.
Ce projet explore l’impact de l’histoire traumatique sur le fonctionnement des gènes (épigénétique). Pouvez-vous nous expliquer cette approche et son intérêt dans le contexte du cancer du sein ?
L’épigénétique représente une découverte majeure : contrairement à la génétique classique, elle étudie comment l’environnement peut « marquer » nos gènes et modifier leur expression sans altérer leur code. Les ACEs laissent des « cicatrices épigénétiques » durables, notamment sur les gènes NR3C1 et FKBP5, cruciaux dans la régulation du stress.
Contrairement aux mutations génétiques, les modifications épigénétiques sont potentiellement réversibles, ouvrant des perspectives thérapeutiques prometteuses si l’on trouve le « bon outil » adapté au « bon patient ».
Comment collaborez-vous avec d’autres chercheurs, avec les professionnels de santé et les patients ?
Le projet CAPONE-Cancer s’inscrit nécessairement dans une approche interdisciplinaire intégrant chercheurs, psychologues, biologistes, spécialistes de la génétique et oncologues. Cette collaboration unique permet de décloisonner les disciplines traditionnellement séparées pour créer une compréhension holistique de l’expérience du cancer et de la rémission.
Les psychologues apportent leur expertise en psychotraumatologie et en évaluation des capacités d’adaptation, tandis que les biologistes analysent les biomarqueurs de stress chronique comme le cortisol. Les spécialistes en génétique explorent les modifications épigénétiques des gènes NR3C1 et FKBP5, pendant que les oncologues fournissent l’expertise clinique sur l’évolution de la maladie et les protocoles de soins. Le chercheur, quant à lui, assure la coordination scientifique de l’ensemble, en articulant les approches disciplinaires, en garantissant la rigueur méthodologique et en veillant à la production de connaissances intégrées et transférables vers la pratique clinique.
Cette approche interdisciplinaire préfigure la médecine de demain, où la collaboration entre disciplines devient indispensable pour comprendre la complexité humaine et développer des interventions véritablement personnalisées et efficaces.
Un dernier mot ?
Nous tenons bien sûr à remercier toutes les participantes volontaires, qui ont donné de leur temps en replongeant dans une période difficile de leur vie. Merci également à tous nos partenaires et associations qui se sont fait le relais de cette étude, jusqu’en Nouvelle Calédonie. Notamment la Ligue contre le Cancer, qui a en plus financé la thèse pour ce projet.
*porteurs du projet :
Pr. Marion Trousselard, chercheure INSPIIRE (Université de Lorraine), Médecin Chef des Services,
Pr. Cyril Tarquinio, directeur adjoint de l’unité de recherche INSPIIRE, Université de Lorraine et Inserm et directeur du Centre Pierre Janet de l’Université de Lorraine,
Dr Christine Rotonda, cheffe du Pôle Recherche au Centre Pierre Janet de l’Université de Lorraine et chercheure à l’unité de recherche INSPIIRE de l’Université de Lorraine et INSERM.



![Vers l'article [Retour en images…] Matinée de sensibilisation aux cancers – Metz](https://factuel.univ-lorraine.fr/wp-content/uploads/2025/09/sensibilisation_cancer_factuel-300x300.jpg)